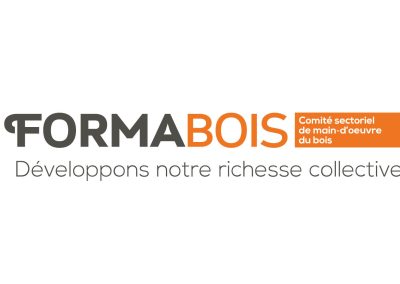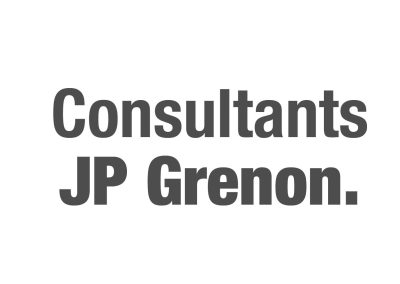Historique
Les ingénieurs forestiers ont contribué à la naissance et à l’évolution de la foresterie québécoise telle qu’on la connaît aujourd’hui. L’apparition de la profession coïncide avec une prise de conscience des problèmes forestiers que l’on observe dans la province au début des années 1910.
Dès qu’ils ont été assez nombreux, les ingénieurs forestiers se sont regroupés en association. Prenant le nom d’Association des ingénieurs forestiers de la province de Québec lors de sa fondation officielle en 1921, celle-ci devient une corporation professionnelle en 1972 et l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec en 1974 est officiellement soumis aux dispositions du Code des professions (RLRQ, ch. C-26). L’Ordre encadre plus de 1900 ingénieures et ingénieurs forestiers exerçant leur profession au Québec et à l’étranger.
L’Ordre a comme principale mission d’assurer la protection du public. À cette fin, il a institué des mécanismes de contrôle de l’admission à la pratique du génie forestier et de surveillance de l’exercice de la profession.
Il assume également cette responsabilité en veillant au respect des règles de pratique professionnelle, en organisant des activités de formation continue à l’intention de ses membres et en intervenant dans les dossiers forestiers en faveur de l’intérêt public.
L’ingénieur forestier doit agir en conformité avec les objectifs de sa profession qui sont l’aménagement intégré, la mise en valeur et l’utilisation ordonnée de toutes les ressources de l’environnement forestier du Québec.
L’ingénieur forestier a acquis, durant ses études universitaires, la formation requise pour dispenser les services professionnels que la Loi sur les ingénieurs forestiers lui réserve en exclusivité. En retour de ce privilège, il doit se soumettre à des règles de pratique rigoureuses et se conformer à un code de déontologie édictant ses devoirs et obligations à l’égard du public, de ses clients et de sa profession.
L’accès à l’exercice de la profession d’ingénieur forestier passe par un processus de reconnaissance défini. Il faut être diplômé en sciences forestières (génie forestier) d’une université canadienne reconnue. Au Québec, seule l’Université Laval offre le programme qui est d’une durée de 4 ans. Les diplômés doivent également compléter un stage de 32 semaines sous la supervision d’un ingénieur forestier.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de 16 personnes comprenant un président élu au suffrage universel, 11 administrateurs élus parmi les ingénieurs forestiers et 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec pour représenter le public dans l’administration des affaires de l’Ordre. Le président agit comme porte-parole officiel de l’Ordre. Le comité exécutif exerce les fonctions que lui délègue le Conseil d’administration et s’occupe de l’administration courante des affaires de l’Ordre. Le siège social a la responsabilité de l’exécution des mandats établis par le Conseil d’administration.
Une vingtaine de comités, animés bénévolement par des membres de l’Ordre, fonctionnent en permanence pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de protection du public tout en faisant progresser et rayonner la profession.
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui, depuis plus d’une centaine d’années, joue un rôle d’importance dans le développement de la foresterie au Québec. L’Ordre a été un acteur de premier plan dans l’adoption de plusieurs politiques forestières au Québec. Il a permis à ses membres d’acquérir un haut niveau de compétence dans l’exercice de leur profession.
Centenaire
Le 19 mars 2021 marquait le centenaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Nous en avons profité pour souligner cet anniversaire en grand et profiter de cette occasion pour faire rayonner la profession aux quatre coins du Québec.
Les ingénieurs forestiers du Québec ont participé à façonner le Québec d’aujourd’hui et à l’évolution des pratiques forestières. La foresterie a contribué de façon marquante à l’établissement et au développement de la population québécoise, ouvrant le territoire d’une région après l’autre.
Ainsi, les ingénieurs forestiers ont su déployer leur science, leurs connaissances et leurs compétences pour mettre en valeur, protéger et conserver les ressources forestières. Ce qui fait que plus de 100 ans plus tard, la forêt, la foresterie et ses forestiers sont encore bien présents.
Nous souhaitons que la population entende parler en bien des hommes et des femmes qui œuvrent à la protection et la mise en valeur de nos forêts, qui s’assurent que la forêt sera là pour toujours et qui font une différence pour y arriver!